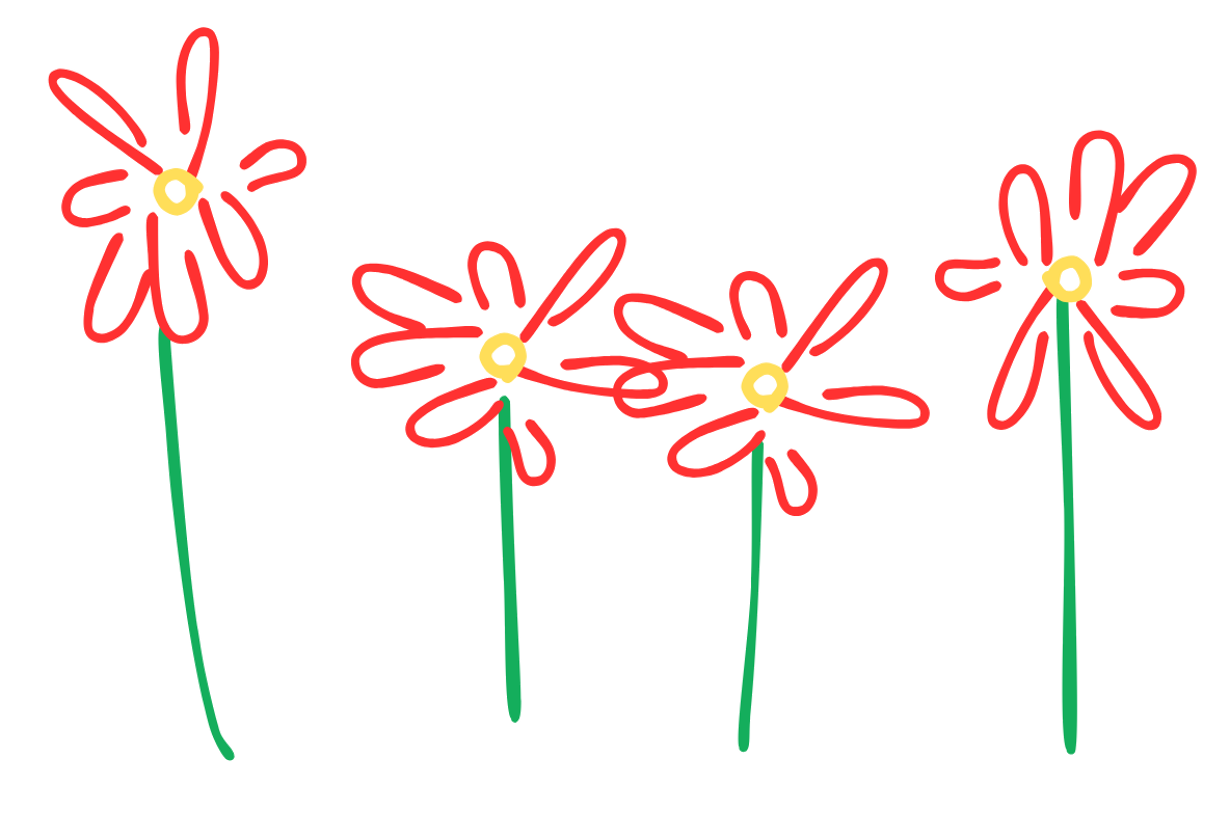Gestion des forêts après les incendies
Que fait-on de nos forêts suite aux incendies ?
Quelques jours après l’incendie dévastateur du 5 août, on pouvait déjà lire dans la presse qu’il allait falloir évacuer le bois brûlé pour « sécuriser et nettoyer » les forêts. Cette unique option avancée par l’ONF, et reprise depuis par des acteurs du territoire comme une évidence, est malheureusement la plus courante.
On trouve maintenant en ligne un appel à dons porté par la Fondation du Patrimoine en collaboration avec l’ONF. La campagne de collecte se justifie par le besoin de « restauration des milieux » impactés par le feu. Mais il est encore question « d’exploitation raisonnée et progressive des bois brûlés », même si l’appel évoque aussi des « opérations d’installation de fascines en travers des pentes, permettant de limiter l’érosion de sols par lessivage » et de « nouvelles zones pare-feux » à aménager. Objectifs affichés : « une reconstruction écologique et paysagère indispensable pour limiter les effets secondaires (érosion, perte de biodiversité, instabilité des sols), soutenir les populations locales profondément affectées par la perte de leur cadre de vie, et préserver l’attractivité du territoire ».
De bonnes intentions, mais la démarche apparaît tout à fait déplacée pour deux raisons :
- l’exploitation du bois brûlé est absolument contraire à l’objectif de régénération, de protection des sols, et donc de préserver l’attractivité du territoire. Et cela, l’ONF ne peut l’ignorer.
- l’appel à la générosité des contribuables face à de tels enjeux d’intérêt général est pour le moins surprenant de la part d’un organisme public comme l’ONF.
L’exploitation du bois brûlé, « raisonnée et progressive », beaucoup de communes de l’Aude ont pu voir ce que cela signifiait. L’ONF n’a plus les moyens, à force de coupes budgétaires, de réaliser lui-même ces travaux. Des contrats sont donc passés avec des entreprises forestières privées pour extraire le bois, le broyer, et le revendre, souvent pour incinération dans des grosses chaudières collectives urbaines.
L’exploitation est « raisonnée » car les contrats les obligent souvent à respecter les structures du paysage, les murets etc… et forcément « progressive » car on ne peut pas tout faire d’un coup.
Mais concrètement ce sont des engins de chantier énormes qui circulent sur les parcelles, compactent les sols, font des ornières dans le sens des pentes, affectent les murets, les terrasses. Ce ne sont pas quelques fascines réalisées sur les pentes les plus fragiles qui vont compenser ce saccage. Le paysage en ressort scarifié, les structures traditionnelles qui limitaient le ruissellement et l’érosion sont dégradées. Et des centaines de camions circulent pendant des mois sur le territoire pour exporter le broyat.
Un exemple d’engins forestiers utilisés pour la fabrication de plaquettes (et ce ne sont pas les plus gros, loin de là !)
Ne laissons pas exporter le bois brûlé des Corbières !
Exporter le bois brûlé, c’est aussi la pire des solutions pour des sols dégradés et calcinés, soumis à des sécheresses récurrentes et à une aridification croissante. Cela ne fait qu’accélérer la marche vers le désert dans laquelle nous sommes déjà engagés.
C’est le choix le moins coûteux dans l’immédiat car il permet de valoriser le bois. Une solution de facilité car le « nettoyage » est réalisé par les entreprises qui profitent de cette manne, tandis que quelques miettes reviennent parfois aux communes, dont on connaît les difficultés financières.
Mais n’est-ce pas un calcul à court terme qui peut coûter très cher demain ? Pour le savoir, nous ne pouvons pas ignorer l’histoire de nos forêts et la signification de leur nature.
Les forêts qui ont brûlé sont dominées, à quelques exceptions près, par le pin d’Alep, qui s’est installé progressivement après l’abandon de pans entiers du territoire. Il a prospéré sur des terres dégradées par 2 000 ans de défrichements successifs et de surexploitation agricole et forestière associés à un climat qui favorise l’érosion et la dégradation organique des sols. Sur des terres instables proches du désert, le pin d’Alep joue un rôle d’espèce pionnière, associé dans un premier temps aux cistes, inules, et autres genêts. C’est le premier grand réparateur de nos sols dégradés.
Récemment encore, la doctrine forestière consistait à dire qu’il fallait le laisser pousser : il restaure le milieu, enrichit les sols en matières organiques, jusqu’à ce que le chêne vert s’installe sous sa canopée. Puis les pins finissent par tomber, et ils ne se renouvellent plus car le milieu s’est amélioré. On retrouve alors une forêt méditerranéenne relativement équilibrée qui continue à s’enrichir et à évoluer au fil des siècles. Ce schéma est juste d’un point de vue écologique, mais absolument irréaliste face à la réalité des incendies. Cette logique a donc évolué : on parle maintenant de reboiser différemment. Mais pour cela, une approche nouvelle s’impose pour ne pas empêcher la régénération du milieu.
Stoppons la marche vers le désert
Le pin d’Alep, même calciné, constitue la première pierre de l’édifice écologique et agricole à reconstruire. Il doit rester sur place. On doit le restituer au milieu ! Une partie de son bois est parti en fumée. Ce qu’il en reste constitue le début de son travail de régénération des sols. En conditions de sols et de climat plus favorables, la valorisation du bois peut s’entendre. Mais ici le réflexe extractiviste doit être abandonné, la responsabilité doit prendre le dessus. La biomasse doit rester sur place.
Si nous exportons le bois, tout repart à zéro et il reste deux options dans le contexte actuel :
- laisser repousser les espèces pionnières, les cistes, les genêts, le pin d’Alep etc… et l’incendie suivant,
- les empêcher de repousser, brider la régénération naturelle, au risque même qu’elle ne recule.
Dans les deux cas, ce qui nous guette, c’est le désert vers lequel les Corbières avancent déjà à grands pas !
Est-il vraiment raisonnable de prétendre ainsi accompagner la régénération naturelle de la forêt méditerranéenne ?
Beaucoup d’acteurs s’entendent aujourd’hui pour affirmer que l’avenir se construira autour d’un soutien à la diversification agricole et à l’élevage. Nous pensons que l’élevage est le premier pilier pour protéger durablement notre territoire contre les incendies. Il est le seul capable d’occuper les vastes massifs des Corbières. Il doit être pensé de manière extensive en association avec une couverture boisée de faible densité comme il en existe dans toutes les régions méditerranéennes où il entretient des milieux riches, source de biodiversité et de bonne hydratation des paysages. Dans des terres dégradées, la mise en place de ces agro-écosystèmes pâturés nécessite un accompagnement ambitieux. La restitution du bois brûlé au milieu en fait partie. Elle permettra au sol de stocker plus d’eau, de nourrir les repousses et les espèces qu’on pourra semer ou planter. Elle aidera à établir le boisement ouvert et fertile qui accueillera un élevage durable et digne. Ainsi tout le paysage sera un pare-feu, mais un pare-feu fertile, productif et habité, pas un milieu dégradé établi sur des sols squelettiques.
Pour autant, on ne doit pas abandonner les Corbières à ces paysages sinistres et dangereux, ni laisser les troncs au sol sans les ébrancher, ce qui serait une entrave au passage des troupeaux. L’aspiration à un paysage nettoyé et sécurisé est légitime, mais il ne doit pas servir de prétexte à choisir la facilité plutôt que la responsabilité !
Rendre les arbres à la terre des Corbières !
Des solutions existent, et les gestionnaires forestiers les connaissent et les maîtrisent très bien :
- fascinage sur toutes les terres en pente ou au pied des terrasses en association avec des haies de repousses,
- passage de broyeurs forestiers là où c’est possible, en conditions adéquates de portance et après avoir repéré les repousses d’arbres à protéger (+ fissurations en courbes de niveau sur les parcelles adaptées),
- abattage et ébranchage pour dégager les passages et réduire l’inflammabilité du combustible,
- un peu de valorisation en circuit court pour l’agriculture peut également aider la diversification (broyat sur friches et cultures pérennes en paillage ; compost pour les replantations immédiates).
Ce bois n’est pas un déchet, c’est une ressource ! C’est la seule richesse organique qu’il reste aux terres brûlées. Sommes-nous prêts à la brader, et avec elle notre avenir, pour quelques économies budgétaires, au lieu de se donner une chance de sortir de ce cercle vicieux ? Nous devons exiger de l’Etat qu’il fournisse aux acteurs locaux les moyens nécessaires à la réalisation de ce travail. Le redressement de ce territoire agricole sinistré en dépend.
Un exemple d’utilisation locale du bois : La scierie mobile est à Fontjoncouse !
Valorisation des grumes partiellement brûlées en planches pour la reconstruction
Il serait indécent, après les discours tenus sur les cendres encore chaudes de ce désastre, après avoir promis un laboratoire de la résilience face aux changements climatiques, de venir piller la maigre fertilité qu’il nous reste. C’est aux habitants et paysans des Corbières de choisir dans quelle direction ils souhaitent infléchir l’histoire de leur pays. Si l’idée de ce laboratoire est d’expérimenter l’apparition du premier désert de France, ce n’est certainement pas du goût de la population des Corbières.
À l’heure où des crises majeures nous guettent, où les alertes se multiplient quant à l’importance de préserver des sols organiques, une institution comme l’ONF, censée participer à la construction d’un avenir viable, ne devrait pas en être réduite à quémander quelques euros aux contribuables et à brader une matière précieuse qui doit constituer le socle de paysages vivants et agricoles.
Après plusieurs siècles d’enrichissement national par l’exploitation excessive des terres du Languedoc, après des décennies de déprise liée à des politiques agricoles et commerciales défaillantes, après 3 ans de sécheresse profonde, après le désastre du 5 août, la population et l’agriculture des Corbières méritent plus de considération que cela. Aujourd’hui, nous sommes légitimes à exiger que l’Etat mette tout en œuvre pour préserver notre avenir.
Il est de notre responsabilité de rendre les arbres à la terre des Corbières…
Nous méritons l’espoir d’un véritable avenir !